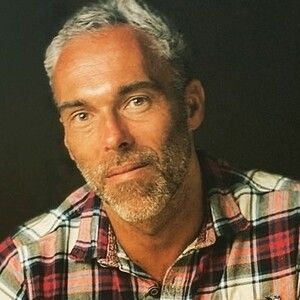Enjeux et Défis autour des Intelligences Artificielles Génératives dans la relation Médecin-Patient

Jérôme Béranger 1, 2, 3
jeromeberanger@hotmail.com
Pr Marie-Eve Rougé-Bugat 1, 4, 5, 6
marieeve.rouge-bugat@dumg-toulouse.fr
1 CERPOP (Centre d'Epidémiologie et de Recherche en santé des POPulations) – Université de Toulouse – Inserm – UPS / 37 allées J. Guesde, 31000 Toulouse
2 GOODALGO / 58 Boulevard d'Arcole, 31000 Toulouse
3 INSTITUT EUROPIA - 2000 Route des Lucioles 06410 Biot
4 Département Universitaire de Médecine Générale Toulouse – Université Paul Sabatier Toulouse III / 133 Route de Narbonne, 31062 Toulouse Cedex
5 Maison de Santé Pluriprofessionnelle Universitaire (MSPU) « La Providence » / 1 Avenue Louis Blériot, 31500 Toulouse
6 Mission « ville-hôpital » – Institut Universitaire du Cancer de Toulouse – Oncopole / 1 Avenue Hubert Curien, 31100 Toulouse
L’introduction des Intelligences Artificielles Génératives linguistiques (IAGén), telles que les Large Language Models (LLM), dans le domaine médical représente une évolution profonde dans la manière dont les soins sont prodigués. Ces technologies transforment progressivement la relation médecin-patient. En tant que système capable de générer un texte cohérent et contextuellement pertinent à partir de vastes ensembles de données, l'IAGén promet une amélioration de nombreux aspects de la prise en soins des patients, tout en soulevant d'importantes préoccupations pratiques et éthiques.
Les promesses des IAGén en médecine :
L’un des principaux avantages des IAGén est leur capacité à améliorer le diagnostic, à personnaliser les traitements et à optimiser la gestion des soins [1]. En analysant de grandes quantités de données cliniques et biologiques, elles peuvent assister les médecins dans l'élaboration de diagnostics précis et recommandent des traitements plus adaptés [2]. ChatGPT et des technologies similaires peuvent faciliter le triage des patients, notamment dans les situations d’urgence ou dans des zones où les ressources sont limitées. L’automatisation des tâches administratives, telles que la gestion des rendez-vous, la rédaction des comptes-rendus et des prescriptions, peut libérer du temps pour les soignants et améliorer l'efficacité du système de santé. Dans le domaine de la recherche médicale, ces outils aident à l'analyse des données cliniques et au recrutement de patients pour des essais. Dans l'imagerie médicale, les IAGén analysent des radiographies et des IRM, détectant des anomalies avec précision, et créent des images synthétiques pour des diagnostics plus rapides. Elles peuvent accélérer la découverte de médicaments en explorant rapidement des milliers d'hypothèses chimiques, réduisant ainsi le temps et le coût du développement. Enfin, les IAGén personnalisent les soins des maladies chroniques comme dans l’adaptation des plans de traitement pour les patients diabétiques, détectent précocement les maladies notamment cardiovasculaires, de santé mentale ou cancéreuses et - en intégration avec des dispositifs connectés - surveillent les signes vitaux des patients en temps réel, ou promeuvent de mode de vie sains. En somme, elles sont en voie de révolutionner les prises en soins, le diagnostic et la recherche médicale, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités pour l'avenir de la santé.
Les limites et risques des IAGén en santé :
Cependant, l’intégration des IAGén dans la pratique médicale soulève des défis considérables. L’un des risques majeurs réside dans la qualité des données utilisées pour entraîner ces modèles [3]. Des données biaisées ou mal étiquetées peuvent entraîner des résultats erronés, ce qui, dans le contexte médical, peut avoir des conséquences graves. De plus, la fiabilité des informations générées par ces modèles reste incertaine. Par exemple, des "hallucinations" algorithmiques peuvent amener à des recommandations médicales incorrectes, mettant en danger la sécurité des patients. Les préoccupations éthiques sont également essentielles [4]. La confidentialité des données personnelles est un enjeu majeur, d'autant plus que ces modèles traitent des informations médicales extrêmement sensibles. L'absence de transparence dans le processus de décision des IAGén rend difficile la vérification de la véracité des réponses fournies. Les risques de discrimination et de biais algorithmiques peuvent également amplifier les inégalités d’accès aux soins. L’intégration des systèmes d’IA peut aussi provoquer une dépendance excessive à la technologie, entraînant une perte de compétences et de savoir-faire chez les professionnels de santé. Ces limites soulignent l'importance d'une utilisation prudente et critique de ces technologies, en prenant en compte les risques associés à leur utilisation, et en s'assurant que les résultats sont évalués par des experts qualifiés.
L’impact sur la relation médecin-patient :
Les IAGén peuvent offrir des avantages significatifs à la relation soignant-soigné en facilitant l'accès à des informations pertinentes. Ces outils peuvent optimiser la gestion des données médicales et personnaliser les interactions, créant ainsi des opportunités pour renforcer l'efficacité des soins et fluidifier la relation entre le médecin et le patient. L'un des aspects les plus préoccupants de l'introduction des IAGén dans la relation médecin-patient est la transformation de cette dualité. La médecine repose sur un échange humain complexe, basé sur l’empathie, l'écoute, l’intuition et la compréhension du contexte émotionnel et psychologique du patient. L'usage excessif des technologies pourrait déshumaniser cette relation, entraînant une perte de la dimension émotionnelle des soins. Bien que les IAGén puissent offrir une aide précieuse dans la gestion des données et des traitements, elles ne sont pas en mesure de remplacer l'intuition et la sensibilité humaine nécessaires pour une prise en charge complète du patient. Les patients, mieux informés grâce à ces technologies, pourraient également être amenés à remettre en question les recommandations des médecins, ce qui pourrait altérer la confiance mutuelle nécessaire à une relation thérapeutique efficace.
Perspectives futures et formations universitaires :
Il est fondamental de définir un cadre éthique et réglementaire rigoureux pour l’utilisation des IAGén en médecine. Les professionnels de santé devraient être formés non seulement à l’utilisation des outils numériques, mais aussi à la manière de maintenir une relation de confiance avec leurs patients dans un environnement de plus en plus digitalisé [5]. L’émergence des IAGén transforme progressivement le rôle du médecin de demain, surtout dans un contexte de médecine digitalisée. Bien que l'IA offre des avantages en matière de diagnostic, de traitement et de gestion des données, il est peu probable qu'elle remplace complètement le médecin. Le rôle du praticien évoluera probablement vers une position de coordinateur, guide et conseiller, en intégrant les outils numériques dans ses pratiques médicales, tout en conservant les qualités humaines indispensables, telles que l'empathie, le ressenti et l'écoute. La médecine de demain devra être une médecine hybride, combinant l'expertise humaine et les capacités des IAGén. Toutefois, l'humain devrait demeurer au centre de cette relation. L'IA doit être utilisée comme un complément et non un substitut à la pratique médicale traditionnelle.
Enfin, il est essentiel de former les praticiens aux bénéfices concrets de l’IA, tout en les sensibilisant à ses limites et aux enjeux éthiques associés. L’université pourrait intégrer ces nouveaux outils dans ses méthodes pédagogiques, notamment via des plateformes numériques, la simulation de cas cliniques ou encore la génération automatique d’épreuves. La formation médicale doit donc se concentrer sur l’acquisition de compétences techniques et éthiques, tout en assurant une articulation fluide entre formation initiale et continue.
En définitive, pour que les IAGén apportent une véritable valeur ajoutée, leur intégration et adoption dans le système de santé doit se faire de manière réfléchie. Une attention particulière doit être portée à l'éthique, à la transparence, l’intégrité et la sécurité des données de santé. Pour cela, il est essentiel que les IAGén répondent à la fois aux attentes du patient et aux exigences du professionnel de santé.
Références bibliographiques
[1]: Tierney A. A, Gayre G, Hoberman B, et al. Ambient artificial intelligence scribes to alleviate the burden of clinical documentation. NEJM Catal 2024. Published online February 21.
[2]: Schwartz N. Google tests ChatGPT competitor at Mayo Clinic. Becker’s Health IT 2023. Published July 10, Accessed June 24 ; 2024.
[3]: Cahan P., Treutlein B. A conversation with ChatGPT on the role of computational systems biology in stem cell research. Stem Cell Rep. 2023; 18, 1–2.
[4]: Béranger J, Tahon E. Les systèmes d’intelligence artificielle : un enjeu pour la qualité et l’éthique de la prise en charge des soins. Risques & Qualité 2023; (20)1:15-22.
[5]: Rougé-Bugat ME, Béranger J. La place du numérique dans le parcours « ville-hôpital » des patients atteints de cancer. Hospitalia ;51:68-72 ; 2020.